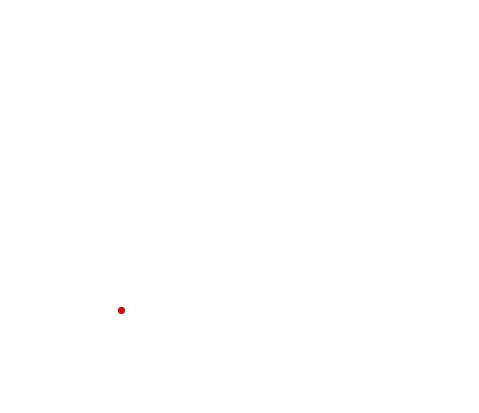Lancement des travaux de chargement horizontal ferroviaire
Jeudi 16 janvier, le Port de Sète-Frontignan et la société VIIA de Rail Logistics Europe ont le plaisir d’annoncer...
Depuis la loi de décentralisation des ports, le port de Sète – Frontignan est la propriété de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, qui a créé en 2007 l’établissement public régional Port de Sète Sud de France, pour gérer ses 3 concessions portuaires ; le port de commerce, le port de pêche et le port de plaisance. Le port de Sète est une structure de type PME de 100 salariés, véritable gage de réactivité face aux attentes des clients professionnels, plaisanciers et de la communauté portuaire sétoise.
Le port de Sète est un véritable levier de développement et de croissance économique, essentiel à la compétitivité des entreprises régionales, il joue également un rôle d’interface entre les différents acteurs dont le développement est directement ou indirectement lié au Port.
Le soutien de la région Occitanie, la réactivité du personnel et la cohésion de sa communauté portuaire, sont d’autant d’atouts dont le Port de Sète dispose pour toujours être compétitif et s’adapter sans cesse aux besoins et évolutions de son marché.
La Région Occitanie est la région la plus attractive de France notamment parce qu’elle dispose de cette magnifique façade méditerranéenne. La Méditerranée avec sa spécificité est et sera de plus en plus au cœur des enjeux majeurs du 21ème siècle, grâce à sa dimension humaine, ses échanges commerciaux, ses relations avec tous les pays qui la bordent, ses atouts touristiques et la richesse exceptionnelle de son patrimoine culturel et régional.
La vision qui anime l’Établissement Public Régional Port de Sète Sud de France comme celle de l’Autorité Portuaire est positive, au service exclusif de l’intérêt général, son objectif prioritaire à relever sont des défis écologiques qui passent par l’innovation ; qu’il s’agisse du développement durable des activités des trois ports de Sète-Frontignan, qu’il s’agisse de la qualité de ses services, de la préservation de l’environnement ou de sa transition énergétique.
Acteur économique dynamique de la façade méditerranéenne, le port de Sète-Frontignan dispose de certains avantages, sa position géographique au cœur du golfe du Lion, ses caractéristiques naturelles, ses accès nautiques privilégiés, mais aussi à sa diversité au travers de ses trois ports de : commerce, pêche et plaisance, en font un acteur régional qui compte.

Le port de Sète génère un nombre significatif d’emplois directs et indirects dans la région. Des travailleurs portuaires, des marins, des employés des entreprises industrielles et des services liés au port contribuent à l’économie locale. De plus, le développement du port lui-même nécessite des investissements et des infrastructures, ce qui stimule l’activité économique dans la région.
En résumé, le port de Sète joue un rôle clé en tant qu’acteur économique régional, en soutenant l’activité pêche face à un secteur instable, en favorisant le commerce international, en abritant des activités industrielles, en soutenant le tourisme et en générant des emplois. Il contribue ainsi au rayonnement économique de la région de l’Occitanie.
Depuis la reprise des ports sétois par la Région Occitanie en 2008, 600 M€ d’investissements auront été réalisés à fin 2024 pour les ports de Commerce, Pêche et plaisance sous la gestion de l’Établissement Public Régional Port Sud de France, avec une répartition 50/50 public-privé.

PORT DE SÈTE
Lancement des travaux de chargement horizontal ferroviaire
Jeudi 16 janvier, le Port de Sète-Frontignan et la société VIIA de Rail Logistics Europe ont le plaisir d’annoncer...
Journées du Patrimoine 2024 : Un jour, un Port !
Journées Port Ouvert : 20, 21 et 22 septembre 2024 Pour les journées européennes du patrimoine, le port de...
La flamme olympique surplombe le port de Sète !
Une journée Olympique sur le Port de Sète Le lundi 13 mai 2024 en matinée, la flamme olympique...
Le Port accueille Escale à Sète 2024 !
Du 26 mars au 1er avril, le port de Sète accueille sur ses quais, l’édition ‘Escale à Sète 2024’....
Port de Sète © 2023 Mentions légales | Plan du Site | Politique de confidentialité | Charte RGAA | Création de site internet Keole.net